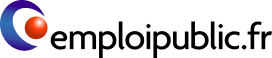Fonction publique : avez-vous pensé à la retraite progressive ?
Finir sa carrière à temps plein peut s’avérer éprouvant. La fonction publique permet aux agents de réduire leur activité tout en percevant une partie de leur pension grâce à la retraite progressive. Qui est concerné ? Quelles conditions remplir ? Comment fonctionne le dispositif ?

© Olivier Le Moal - Adobe Stock
La retraite progressive : de quoi parle-t-on ?
À l'approche de la retraite, un agent public peut demander à réduire son temps de travail et à percevoir une partie de sa pension de retraite. En d'autres termes, l’agent continue d’exercer son activité professionnelle à temps partiel et la fraction non travaillée est compensée par le versement d’une pension. Ce dispositif offre un complément de revenus et une transition en douceur entre l’activité et la retraite complète.
>> A lire aussi : Paiement des pensions de retraite : le calendrier
Quels sont les critères pour être éligible à la retraite progressive ?
-
Avoir atteint 60 ans minimum.
Cette condition vaut aussi bien pour les agents des catégories sédentaires que pour les agents des catégories actives ou super-actives. En vigueur depuis le 1er septembre 2025 (décret n°2025-681 du 15 juillet 2025), cette uniformisation de l'âge pour les catégories vise à simplifier les règles et promouvoir une transition souple vers la retraite pour tous. - Justifier d’au moins 150 trimestres cotisés ou assimilés tous régimes de base confondus, incluant périodes de chômage, maladie, majorations pour enfants, etc.
Quelle quotité de travail maintenir pendant la retraite progressive ?
Pour toucher une partie de sa pension de retraite, le fonctionnaire doit au moins continuer à travailler à 50% de son temps plein et jusqu'à 90% de celui-ci. En cas de cumul d’emplois, la somme des quotités de travail ne peut pas dépasser 90% d’un temps complet.
Comment est calculée la pension partielle ?
La pension de la retraite progressive correspond à la part du temps de travail que l’agent n’effectue plus. Par exemple, un agent qui choisit de travailler à 60% percevra 40% d’une pension calculée sur ses droits acquis. Cette pension est liquidée sur la base du traitement de référence au moment de la demande, en tenant compte des accessoires de rémunération comme la NBI (nouvelle bonification indiciaire), dès lors que les conditions pour en bénéficier sont respectées.
Lorsqu’il liquidera définitivement sa retraite, la période de retraite progressive sera intégrée dans le calcul de sa durée d’assurance. La pension définitive ne pourra pas être inférieure au montant déjà perçu lors de la retraite progressive.
>> A lire aussi : Retraite des fonctionnaires : l’essentiel en 10 points
Le dispositif concerne-t-il les fonctionnaires à temps partiel, non complet et incomplet ?
Oui, un fonctionnaire travaillant à temps partiel peut prétendre à une retraite progressive, dès lors que sa quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d'un temps plein.
S'agissant des agents à temps incomplet ou non complet, la retraite progressive peut être accordée sans réduire leur temps de travail, mais le cumul d’emplois reste limité à 90% d’un temps complet. Par contre, la retraite progressive n'est pas incompatible avec le temps partiel thérapeutique.
>> A lire aussi : Temps complet, non complet, temps partiel : quelles différences ?
Comment demander sa retraite progressive ?
Si l’agent n’est pas déjà à temps partiel, il doit en faire la demande auprès de son employeur en même temps qu’il sollicite sa retraite progressive auprès de son organisme de retraite. Les demandes doivent être déposées au moins six mois avant la mise en place du dispositif. À noter que le temps partiel nécessaire à la retraite progressive peut être refusé par l'employeur si les besoins du service ne permettent pas un tel aménagement.
Quelle est la durée de la retraite progressive ?
La retraite progressive prend fin si l’agent reprend son activité à temps complet, ou s’il décide de liquider définitivement sa pension. Dans certains cas, la limite d’âge peut être repoussée, car la réglementation est compatible avec les dispositifs de recul de la limite d’âge, comme la prolongation d’activité ou le maintien en fonction.
Quel impact sur le calcul de la retraite ?
Pendant sa retraite progressive, l’agent continue de cotiser. Ainsi, si au moment de demander sa retraite progressive, il n’avait pas encore tous ses trimestres, cela lui permet de compléter ses droits. Et s’il avait déjà atteint le taux plein, ces cotisations ne sont pas perdues. Elles donnent lieu à une surcote, un bonus appliqué au montant de sa pension.
>> A lire aussi : Retraite du fonctionnaire : racheter ses années d'études pour la retraite
La retraite progressive s’applique-t-elle aux contractuels ?
Pour les contractuels, le système de retraite progressive s'aligne sur le privé. Par rapport aux titulaires, les contractuels devront travailler au moins 40% de leur temps complet et jusqu'à 90%. Si le contractuel a plusieurs employeurs, les durées agrégées devront vérifier ces seuils. Comme les fonctionnaires titulaires, les contractuels peuvent partir en retraite progressive à l'âge de 60 ans et avoir cotisé au moins 150 trimestres ou assimilés.
>> A lire aussi : Quelle retraite pour les contractuels de la fonction publique ?
La fonction publique recrute
Vous souhaitez avoir un travail qui a du sens ? Rejoignez la fonction publique !
Les autres articles du dossier : La retraite des fonctionnaires
- Décès d'un fonctionnaire : le point sur la pension de réversion
- Fonctionnaires : le point sur la retraite anticipée pour invalidité
- Retraite du fonctionnaire : racheter ses années d'études pour la retraite
- Cumul emploi-retraite du fonctionnaire : ce qu'il faut savoir
- Retraite des fonctionnaires : l'essentiel en 10 points
- Quelle retraite pour les contractuels de la fonction publique ?
- Paiement des pensions de retraite : le calendrier 2026
- Retraites : ces professions qui craignent la réforme
- Retraite : les convergences entre le secteur public et privé
- Retraités du public versus retraités du privé : à qui l'avantage?