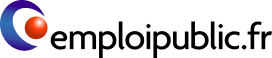Recrutement dans la fonction publique : Florent nous raconte son expérience candidat
Florent Renucci, directeur adjoint des affaires juridiques des Assemblées et du patrimoine de Grand Paris-Sud-Est Avenir, revient sur ses expériences de recrutement et les outils mis en place pour améliorer l’expérience candidat dans la fonction publique. De la gestion des candidatures via une plateforme dédiée à l’activation de réseaux spécialisés, il partage ses conseils pour attirer les bons profils et rendre le processus plus interactif et ciblé.

© Leo Lintang - Adobe Stock
Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours (formation, spécialisation, stages, etc.) avant d'intégrer votre poste actuel ?
J’ai suivi un parcours assez classique de juriste : après une fac de droit, j’ai poursuivi avec un Master 2 en droit des collectivités territoriales, qui avait la particularité d’être en alternance.
À l’époque, l’alternance était encore peu répandue dans le domaine juridique, mais c’est justement ce qui m’a attiré. J’ai donc intégré une collectivité avec un rythme assez soutenu : trois jours en collectivité (lundi, mardi, mercredi) et trois jours en cours (jeudi, vendredi et samedi matin). Cela ne laissait pas beaucoup de temps libre, mais c’était une excellente opportunité pour acquérir rapidement de l’expérience tout en étant encadré.
À la fin de mon apprentissage, la collectivité m’a proposé un contrat, puis j’ai enchaîné plusieurs contrats successifs jusqu’à atteindre six ans d’ancienneté, ce qui m’a permis d’obtenir un CDI. Ensuite, j’ai passé le concours d’attaché, que j’ai réussi, et une opportunité s’est présentée pour prendre le poste de directeur adjoint. Étant donné mon ancienneté – cela fait maintenant plus de 11 ans que je suis dans cette collectivité – cette évolution s’est faite naturellement.
Comment avez-vous connu votre employeur actuel ? Était-ce lors d’un événement, via une plateforme, ou autrement ?
J’ai connu mon employeur grâce à mon alternance. Le Master 2 proposait une liste de collectivités partenaires prêtes à accueillir des apprentis pour une année. J’ai donc envoyé des candidatures spontanées à plusieurs d’entre elles. J’ai eu la chance que cela matche assez vite : j’ai reçu rapidement une réponse de la collectivité qui m’a ensuite recruté, d’abord en tant qu’apprenti, avant d’y évoluer progressivement jusqu’à mon poste actuel.
Je n’ai donc pas eu à enchaîner les entretiens ni à faire face à de grandes difficultés pour trouver un poste. Cela s’explique aussi par le fait que le Master 2 était bien structuré et reconnu : l’alternance était une véritable valeur ajoutée et les étudiants étaient bien accompagnés dans leurs démarches. Nous n’étions pas livrés à nous-mêmes pour trouver une alternance, ce qui rendait ce Master particulièrement attractif.
Avez-vous bénéficié d’un accompagnement de votre école pour faciliter votre recherche ?
Pas particulièrement, à part la liste des collectivités partenaires, ce qui était déjà un grand atout. À l’époque, l’alternance en droit était encore assez rare, ce qui rendait cette offre particulièrement attractive. Il n’y avait pas besoin de forums de recrutement ou d'autres événements similaires. Cela créait un petit "microcosme" où les collectivités et les étudiants intéressés par cette alternance se retrouvaient facilement.
>> A lire aussi : Comment se préparer à un salon de l'emploi ?
Comment s’est déroulé le processus de recrutement ? Quels outils ou étapes vous ont marqué ?
Tout s’est fait assez naturellement, sans véritable acte de candidature formel. J’ai évolué au sein de la collectivité pendant dix ans avant de prendre mon poste actuel. Cette progression s’est faite de manière fluide, sans que je ressente le besoin de me « vendre » comme lors d’un processus classique de recrutement.
Lors de mon alternance, la transition vers le plein temps a constitué un moment clé. Jusqu’en avril, nous étions en alternance à moitié en collectivité, moitié à la fac. Ensuite, nous passions à plein temps en collectivité, ce qui demandait un réel ajustement. Les attentes changent complètement : en tant qu’apprenti, on est encore en formation, alors qu’une fois à temps plein, on devient un agent à part entière avec davantage de responsabilités. Cette période d’adaptation a été exigeante, mais elle m’a permis d’acquérir une autonomie essentielle.
J’ai eu la chance d’être bien accompagné, notamment par ma maître d’apprentissage, qui est toujours dans la collectivité aujourd’hui. Elle a été ma N+1, puis ma N+2, et continue à me pousser à progresser. Cet accompagnement constant a joué un rôle clé dans mon évolution et explique en grande partie pourquoi je suis resté aussi longtemps dans la collectivité. J’ai toujours eu l’opportunité d’apprendre et de me perfectionner, ce qui a rendu cette évolution naturelle.
>> A lire aussi : Temps complet, non complet, temps partiel : quelles différences ?
Quel aspect de l’approche de la collectivité vous a donné envie de postuler ?
Ce qui m’a vraiment attiré, c’est la possibilité d’une formation sur-mesure grâce à l’alternance. Ce type de programme permet de modeler un profil en fonction des besoins spécifiques de la collectivité, et de l’amener à devenir un agent adapté à toutes les situations. Cette approche de formation en alternance est un vrai atout, car elle permet d'intégrer progressivement la culture de la collectivité et de s’impliquer dans son fonctionnement quotidien.
Cependant, avec le temps, j’ai pris conscience que l’un des défis actuels est le manque de temps pour accompagner les nouveaux comme cela a été le cas pour moi. Aujourd’hui, avec la charge de travail et les contraintes de la collectivité, il est plus difficile de former les apprentis de manière aussi approfondie et de leur donner envie de rester.
Pour ma part, j’ai eu la chance que l’on me donne suffisamment d’opportunités pour m’intégrer et progresser, ce qui a renforcé mon envie de rester dans la collectivité. Mais il est essentiel que les employeurs comprennent que l’apprentissage est un pari sur l’avenir. Ce n’est pas juste un moyen de valider un diplôme, mais une vraie opportunité de former des talents à long terme. Pour cela, il faut valoriser davantage ce processus et permettre aux apprentis de s’investir dans la culture propre de la collectivité.
En ce qui concerne le Grand Paris Sud-Est à venir (GPSEA), je dirais qu’il s’agit davantage d’un rythme de start-up que d’une petite collectivité traditionnelle. Ça bouge au quotidien, et cette dynamique peut être un peu déroutante au début. Mais étant resté depuis le début, j’ai grandi avec cette philosophie. C’est cette adaptabilité et cette agilité qui, à mon avis, doivent être valorisées dans les expériences d’apprentissage. Les jeunes talents doivent sentir que l’apprentissage leur ouvre des portes et qu’ils ont un avenir possible au sein de la collectivité, au-delà de la simple validation d'un diplôme.
>> A lire aussi : Réussir l'onboarding en 6 étapes
Qu’est-ce qui vous a convaincu que cet employeur était le bon pour vous ?
Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est avant tout l’accompagnement que j’ai reçu, notamment de la part de ma maître d'apprentissage. Elle est brillante, m’a tout appris, et continue à m’enseigner aujourd’hui. Cet accompagnement de qualité m’a permis de me développer à la fois professionnellement et personnellement, ce qui m’a donné envie de rester dans cette collectivité.
Mais ce n’est pas tout. Ce qui m'a attiré aussi, c’est la diversité des missions. Lors de mon recrutement, j'étais un juriste généraliste, ce qui signifie que je n’étais pas enfermé dans une spécialité, mais que je touchais à de nombreux domaines : du droit de la fonction publique, à l’urbanisme, en passant par des dossiers d’assurance. Mon service couvre une multitude d'aspects : l'organisation des assemblées, la gestion du patrimoine immobilier, et bien d’autres aspects de la gestion d'une collectivité. Cette polyvalence fait qu’on ne se lasse jamais et qu’on apprend sans cesse. C’est d’ailleurs ce côté multidisciplinaire qui m’a donné envie de rester : ce n’est pas un simple service juridique où l’on se contente de rédiger des contrats ou d’analyser des documents.
Bien sûr, il y a des moments où l’on peut ressentir une certaine frustration à ne pas être hyper spécialisé, à devoir revenir sur des sujets que l’on a déjà traités. Mais, au final, la polyvalence compense largement ce manque de spécialisation : on maîtrise un nombre de sujets très variés et on n’a jamais le temps de s’ennuyer.
Selon vous, qu’est-ce que les collectivités devraient faire pour mieux se rendre visibles et attirer les jeunes talents ?
Je pense que la visibilité des collectivités dépend beaucoup de leur type et de leur organisation. Pour les collectivités de taille intermédiaire, comme celles en intercommunalité, il est souvent difficile de faire comprendre aux jeunes où elles interviennent exactement. Par exemple, quand je travaillais dans une communauté d'agglomération, c’était compliqué d’expliquer ce que l’on faisait, et cela n’était pas toujours perçu de manière claire. Les gens ne savent pas toujours qui fait quoi dans la structure territoriale, et cela peut freiner le recrutement.
Je crois que c’est plus facile pour les grandes collectivités, comme les communes, les départements ou les régions, qui sont des entités bien identifiées et mieux reconnues. Il y a moins de confusion pour les candidats potentiels, car tout le monde sait ce que fait une grande mairie, par exemple. Pour les structures plus petites ou intercommunales, il y a un vrai enjeu de pédagogie : expliquer qui fait quoi et quelles compétences sont gérées.
Les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle essentiel ici. Il est crucial d’utiliser des canaux numériques pour mettre en avant les actions des collectivités et montrer qu’elles sont au service des citoyens. Par exemple, les compétences visibles au quotidien, comme la gestion des ordures ménagères, sont des actions concrètes que tout le monde perçoit. Mettre en avant ces aspects peut être une bonne manière de rendre visible l’impact direct des missions publiques.
Pour toucher spécifiquement les jeunes, il est important d’être présent sur les bons canaux. Les réseaux sociaux sont essentiels pour attirer l’attention des nouvelles générations. Il faut être capable de s’adapter rapidement aux nouvelles plateformes et aux modes de communication actuels, car ce qui fonctionnait avant (comme la publicité sur les bus) n’est plus aussi efficace aujourd’hui. Il y a aussi des efforts à faire pour simplifier le message : ce n’est pas uniquement de la gestion administrative, mais bien des actions concrètes qui ont un impact direct sur la vie des citoyens.
Enfin, je pense que chaque collectivité devrait faire un effort pour être identifiable comme un employeur potentiel. Si les jeunes savent ce que la collectivité fait, en quoi elle est utile au quotidien, et surtout, s’ils la perçoivent comme une structure dynamique et innovante, ils seront plus enclins à s’y intéresser pour y travailler. La visibilité est donc la clé : une collectivité qui se fait connaître pour ce qu’elle fait et comment elle le fait, devient un lieu attractif pour les talents.
>> A lire aussi : Fonction publique territoriale : quelle collectivité intégrer ?
Quels types de contenus vous semblent les plus impactant pour mieux comprendre une collectivité ?
Je pense que la réponse varie en fonction de la collectivité elle-même. Il n'y a pas de recette unique, car chaque territoire, chaque collectivité, a des spécificités qui nécessitent une communication adaptée. Par exemple, une grande commune urbaine comme Créteil, avec plus de 80 000 habitants, aura des besoins et un type de communication très différents d'une petite commune rurale de moins de 2500 habitants. Il est essentiel de s’adapter à l’audience visée, à son environnement et à ses attentes.
Cela dit, certains types de contenus peuvent avoir un impact significatif. Les vidéos, par exemple, sont particulièrement efficaces pour capter l'attention des jeunes. Cependant, il est important de ne pas seulement produire des vidéos, mais aussi de les rendre visibles sur les bonnes plateformes et au bon moment. Les vidéos permettent de mettre en valeur des projets concrets, de montrer l’impact direct de l’action publique et de donner un visage humain à la collectivité. Par exemple, une vidéo qui présente des projets d'aménagement urbain ou qui montre comment une collectivité gère l’assainissement ou les déchets peut être très parlante.
Dans certains cas, des témoignages de citoyens ou de collaborateurs de la collectivité peuvent aussi être très efficaces. Ceux-ci permettent de donner une dimension humaine et de renforcer la crédibilité. Des témoignages sur la vie quotidienne dans une collectivité, ou sur des projets qui ont changé la vie des administrés, peuvent être plus percutants qu'une simple présentation des actions de la collectivité.
Enfin, il y a des cas où il est pertinent de se concentrer sur des projets concrets, en mettant en lumière des réalisations locales ou des missions spécifiques qui ont un impact direct sur les citoyens. C'est un moyen de montrer que la collectivité ne se contente pas de bureaucratie, mais qu'elle est aussi au service des administrés à travers des projets tangibles.
Un autre exemple serait de cibler des métiers en tension dans la collectivité, comme celui des maître-nageurs, qui a des difficultés de recrutement. Dans ce cas, on pourrait imaginer des vidéos ou des campagnes mettant en avant des personnalités locales ou des figures de la natation pour susciter l’intérêt et attirer des candidats.
En résumé, il est important de diversifier les formats et de bien choisir le contenu en fonction de l’audience et du contexte spécifique de la collectivité. Il faut que la communication soit ciblée et adaptée à chaque situation pour maximiser son impact.
Avec le recul, quels conseils donneriez-vous à un jeune candidat pour réussir sa recherche d’emploi ?
1. Se renseigner sur la collectivité
Lorsque l’on postule dans une collectivité, il est crucial de bien comprendre ses compétences, son organisation et sa gouvernance. Ce sont des éléments souvent abordés lors des entretiens de recrutement. Un jeune candidat doit montrer son intérêt pour l’action publique et comprendre le rôle de la collectivité, ses projets et son fonctionnement. Postuler uniquement pour obtenir un emploi, sans s'intéresser à l’organisation et à l’activité de la collectivité, peut être perçu comme un manque d’implication.
>> A lire aussi : Savoir-faire et savoir-être : faites valoir vos compétences en entretien de recrutement
2. Montrer un intérêt pour la fonction publique
Dans le secteur public, et notamment au sein des collectivités, il est important de démontrer un véritable intérêt pour l'action publique. C’est un aspect essentiel qui peut faire la différence entre un candidat qui postule sans réelle motivation et un autre qui a une compréhension profonde de l'impact de son travail sur la communauté et les citoyens. Le candidat doit comprendre que travailler dans une collectivité implique de participer à la gestion des services publics, qui sont au service de la population.
3. Utiliser des plateformes centralisées pour la recherche d'emploi
Une plateforme centralisée qui recense l'ensemble des offres d’emploi des collectivités serait un outil précieux pour simplifier la recherche d'emploi. Elle permettrait de mieux orienter les candidats vers des offres adaptées à leurs compétences et à leurs attentes. Cela éviterait la confusion liée à la diversification des plateformes et permettrait de se concentrer sur les opportunités proposées par les collectivités. Une fois l'offre trouvée, il est conseillé de se rendre sur le site de la collectivité pour approfondir les informations et connaître d'autres opportunités.
4. Adapter sa candidature à l’offre spécifique
Après avoir trouvé une offre intéressante, il est important de personnaliser sa candidature en fonction des spécificités de la collectivité et du poste proposé. Montrer que l’on a pris le temps de se renseigner sur les missions de la collectivité et ses projets à venir renforcera l’argumentaire et démontrera un engagement sincère envers la fonction publique.
En résumé, pour réussir dans la recherche d’emploi dans une collectivité, un jeune candidat doit s’assurer de bien comprendre l’environnement et l’organisation de la collectivité, et d’adopter une approche proactive et intéressée envers l’action publique. Utiliser des plateformes centralisées et se préparer pour les entretiens en montrant son intérêt et sa motivation pour l’emploi proposé est clé.
Si vous deviez donner une note globale à votre expérience de recrutement, quelle serait-elle, et pourquoi ?
Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 9,5. Mon expérience de recrutement a été excellente, principalement grâce à un accompagnement exceptionnel. L’accompagnement tout au long de mon parcours a vraiment fait la différence. J’ai eu la chance de bénéficier d’un soutien constant, ce qui m’a permis de progresser régulièrement.
Le système d'apprentissage que j'ai suivi était assez novateur, en particulier pour des études juridiques, et il m’a permis d’évoluer sur le plan fonctionnel avant même de passer à un poste hiérarchique. J’ai pu gérer des dossiers de plus en plus complexes, ce qui m’a donné confiance et m’a montré que l’on croyait en moi. Cela a vraiment fait partie de mon développement et de ma progression dans la collectivité.
Qu’est-ce qui pourrait améliorer encore l’expérience candidat selon vous ?
L'expérience candidat pourrait être encore améliorée grâce à une meilleure interaction et communication avec les candidats, en complément de la plateforme de gestion des candidatures que nous avons mise en place. Bien que la plateforme soit pratique pour recenser, comparer et organiser les candidatures, il y a une opportunité d’enrichir cette expérience en ajoutant un suivi plus personnalisé. Par exemple, après la réception des candidatures, une interaction régulière (comme des retours ou des mises à jour sur l’état du recrutement) permettrait de renforcer l’engagement du candidat tout au long du processus.
Dans le cadre de profils spécialisés, l’activation de réseaux ciblés comme des partenariats avec des universités ou des salons spécialisés semble pertinente, en particulier pour des profils comme les juristes. Bien que les salons très généraux ne soient pas toujours adaptés, des événements plus spécifiques, comme des salons dédiés au droit public ou en collaboration avec des facultés de droit, pourraient être des occasions idéales pour attirer des candidats plus ciblés.
De plus, il serait intéressant d’explorer un système permettant de recontacter facilement des candidats pour de futurs postes en gardant leur profil dans une base de données centralisée, comme cela semble être le cas pour les candidats passés qui pourraient correspondre à de nouveaux recrutements. Cela permettrait non seulement de gagner du temps, mais aussi d’entretenir une relation continue avec les talents identifiés au fil des recrutements.
Les autres articles du dossier : Grand Paris Sud Est Avenir - Pourquoi nous rejoindre ?